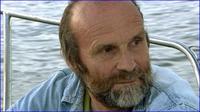Situées dans le sud de l’océan indien, les îles Crozet et Kerguelen présentent un climat océanique froid caractérisé par des vents violents, des précipitations importantes (750 à 3000 mm par an selon les îles et l’exposition) et des températures basses (moyennes mensuelles comprises entre 2 °C et 8 °C). En relation avec ces conditions contraignantes et l’isolement extrême de ces îles, la biodiversité des écosystèmes terrestres est faible. Le nombre d’espèces autochtones est réduit : une vingtaine de plantes à fleurs, une quarantaine d’insectes, et aucun mammifère terrestre. Par contre, les peuplements en oiseaux marins sont parmi les plus riches au monde, 35 espèces nidifiant dans l’archipel de Crozet et 33 à Kerguelen.
La biodiversité de ces îles est soumise aujourd’hui à deux menaces importantes :
Les introductions d’espèces
Volontaires ou fortuites, les introductions de plantes, d’invertébrés et de mammifères, sont étroitement liées à la fréquentation humaine, plus intense depuis l’installation des bases permanentes au milieu du XXème siècle. A Crozet et Kerguelen on dénombre actuellement une soixantaine de plantes introduites dont certaines entrent en compétition avec les espèces autochtones. Parmi les insectes, un coléoptère prédateur introduit depuis les îles Falklands, Oopterus soledadinus, menace certains insectes de l’archipel de Kerguelen, notamment la mouche aptère, Anatalanta aptera, par ailleurs en interaction avec une mouche bleue introduite (Calliphora vicina). Parmi les mammifères, un herbivore et un carnivore, le lapin et le chat, ont transformé les communautés végétales et animales par élimination des espèces les plus sensibles, en particulier le chou de Kerguelen (Pringlea antiscorbutica) et les petites espèces de pétrels et prions à nidification hypogée. Un programme de restauration de petites îles par éradication du lapin et contrôle du chat a été initié en 1992 dans l’archipel de Kerguelen afin d’étudier la résilience des communautés.

Oopterus soledadinus
le changement climatique
A Kerguelen on enregistre une augmentation des températures moyennes de 1.3 °C depuis les années 1960 et, depuis le début des années 1990, une diminution des précipitations entraînant des sécheresses estivales de plus en plus marquées. Il en résulte un retrait général des glaciers et, dans l’est de l’archipel, une diminution significative du recouvrement des plantes autochtones au profit des introduites, dont le pissenlit (Taraxacum officinale).
La conjonction de ces deux perturbations - introductions d’espèces et changement climatique - se traduit par une régression de la biodiversité en espèces autochtones et une banalisation des communautés végétales et animales. Les travaux, menés à différentes échelles, depuis les adaptations physiologiques des individus jusqu’à la structure et la dynamique des communautés, sont intégrés dans des programmes nationaux et internationaux de recherche sur les changements globaux de l’environnement en zone polaire et subpolaire.
Travaux de Marc Lebouvier & Jean-Louis Chapuis
(Sources : http://www.ifremer.fr - http://www.botanical.com/)
Travaux de Marc Lebouvier & Jean-Louis Chapuis
(Sources : http://www.ifremer.fr - http://www.botanical.com/)
Mots-clés : biodiversité crozet kerguelen prédateur île introduction CNRS ifremer climat climatique